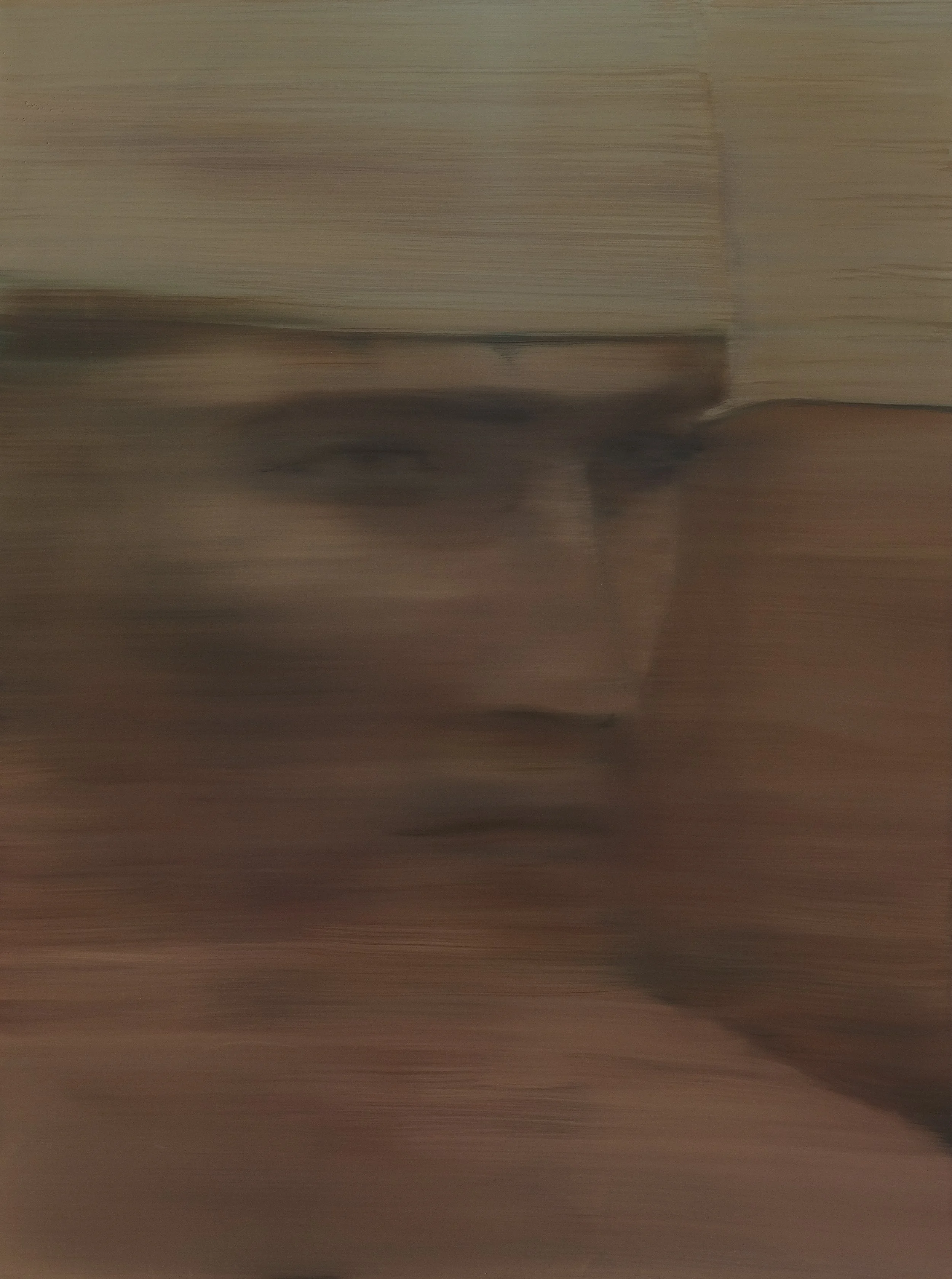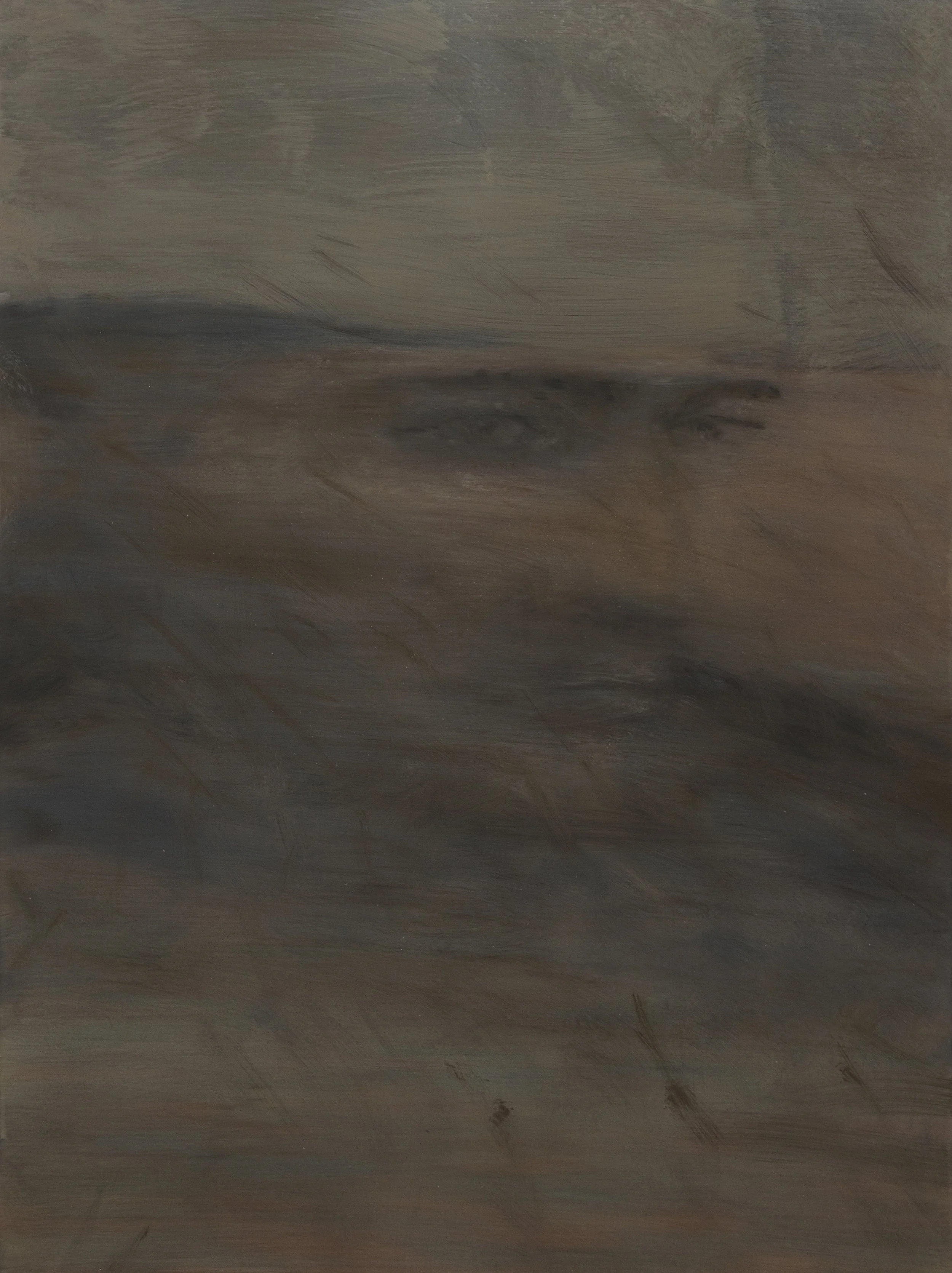Critique d’art,
Julien Heintz présenté aux Beaux-Arts de Paris dans l’exposition
L’Art et la vie et inversement
du 12.02. au 16.03.2025
Ab extra
Que reste-t-il ? Quand le jour s’est perdu, quand décoloré, émoussé, il s’est fondu dans l’oubli. Il y a indubitablement les naufrages de la mémoire, les absences et les silences multipliés. Il y a, derrière nous qui se presse, cette foule de petites gens éparpillées dans le passé, éteinte. Dans ce chaos, est-il vrai que tout passe ? Julien Heintz saisit précisément là, dans les ombres, dans ce qui sombre, un sens, dessus, dessous.
Présentées dans l’exposition L’art et la vie et inversement (sous le commissariat d’Anaël Pigeat) qui rendait hommage aux artistes félicités par le jury des Beaux-Arts de Paris, les œuvres de l’artiste « gifle l’œil ».
Julien Heintz, Deux liquidateurs de Chernobyl en 1986, 2024, huile sur toile, 130x97cm
Accepter l’ignorance
A partir d’une photographie ou d’une vidéo documentaire de la première moitié du XXème siècle, Julien Heintz illustre une série de corps spectraux, soit, une somme de corps qui reviennent et se donnent à voir de nouveau, cantonnés au visible.
Il se tient toutefois, au seuil du portrait car il est impossible d’identifier strictement ces spectres. D’autant qu’il n’y a pas de contexte : les individus sont peints sur un seul plan. Ceux-ci n’ont pas de nom. L’essentiel s’échappe. Seul le titre comble les lacunes. Quelque chose reste là, suspendu : Julien Heintz met en tension la reconnaissance. Peut-être parce qu’il est vain de vouloir reconnaître un spectre, de l’associer tout à fait à une connaissance. Sans révélation possible, il faut accepter de renoncer à l’individualité et ne plus considérer que le groupe. D’ailleurs, dans la mémoire collective, l’individu est toujours dissout dans un ensemble : on se rappelle des soldats de telle armée, des rescapés de telle ou telle catastrophe. L’artiste fait en sorte que les vides se répondent (plaçant à la rime vacuité et vanité) et, paradoxalement, ceux-ci remplissent un peu le rien.
Julien Heintz, Deux liquidateurs de Chernobyl en 1986, 2024, huile sur toile, 130x97cm
Ombres légères, songes
La réapparition de ces corps implique plusieurs transformations. La touche du peintre éclot dans ces transformations : un visage agrandi et plat se colle tant et si bien à la paroi du tableau qu’il en est tout défiguré. L’artiste brosse sur la toile de grandes lignes horizontales qui structurent l’image. Les traits du visage glissent sur les ombres grasses et la face comme étirée d’hier à aujourd’hui, démesurée maintenant, débordant du cadre parfois, n’est plus reconnaissable. Elle fait surface. Elle est support, destinée à exciter la pensée.
Julien Heintz pointe d’abord un au-delà, cet ailleurs véritable qu’est la mort. Il figure ce qu’on pourrait nommer l’étrangereté, puisqu’il est question de sonder les qualités de l’étranger : de cerner mieux celui qui est au plus loin de soi parce qu’il est mort. Il explore cette étrangèreté donc, dans laquelle l’Autre devient Autre pour de bon. Regarder l’œuvre du peintre, c’est être Ulysse dans les Enfers, c’est porter son regard de l’autre côté de l’eau, c’est se confronter ainsi, lucide, à cet Autre qui a perdu sa lumière. Âme seulement, dénué de chair, dénué d’os, immatériel.
« (…) je n’avais qu’un désir : serrer entre mes bras l’ombre de feu ma mère… Trois fois, je m’élançai ; tout mon cœur la voulait. Trois fois, entre mes mains, ce ne fut plus qu’une ombre ou qu’un songe envolé. »
Homère, L’Odyssée, Chant XI, v.205-208, traduction de Victor Bérard
Les camaïeux terreux dessinent l’âme : tout est brun, tout est sombre, consumé. Consumé oui, mais pourtant il reste bien quelque chose
L’empreinte de ce qui fut
Les coups de pinceaux horizontaux apparents figurent le passage, l’avancée. Il disent aussi en un sens, la vigueur. La marche du temps est là, exhibée dans la ligne. Comme cela bouge ! Julien Heintz peint l’Histoire. Le visage se déploie en contraste, vertical, limité dans son champs. Sa réalité passe et le dépasse.
L’inclination des visages permet de creuser les ombres. L’image naît de l’obscurité. Le regard, toujours plus saillant, affleure en premier. Il suffit pour faire figure. Réduit à cette courbe essentielle, le spectre est individualisé. Que cache-t-il sous ses paupières ? A qui destinait-il ce coup d’œil ? Son regard se révolte depuis le brouillard de la mémoire et emportent notre attention. Il est la lucarne qui ouvre grand sur notre ignorance et, consécutivement, sur notre curiosité. Tout le reste, ce sont des mots - ces « mots qui leur restent au coin des yeux » dirait René Char - qu’on utilise pour sceller nos impressions, celles qui recouvrent l’œuvre, l’habillent, la font vivre.
Julien Heintz représenté par Pal Project – la galerie audacieuse des frères Lorquin, qui met en valeur les artistes émergeants - possède une acuité remarquable et beaucoup de talent. Il est un des acteurs incontournables de la scène artistique parisienne, à suivre donc, de très près.
25 mars 2025